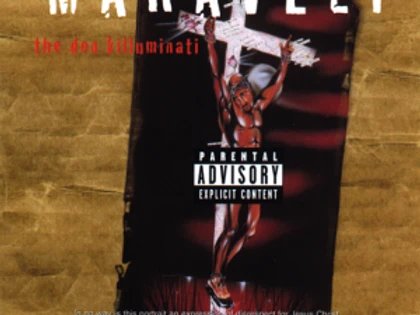Blog,Culture africaine,Santé mentale/Neurosciences/Psychologie Cognitive,Spiritualité
Le Zār : Esprit, transe et thérapie en Afrique
Le Zār (زار en arabe, ዛር en guèze) est plus qu’un phénomène culturel : il est une architecture thérapeutique complexe, un genre musical envoûtant et une cosmologie d’esprits qui s’étendent de la Corne de l’Afrique jusqu’aux portes du Moyen-Orient. Ce culte de possession, pratiqué majoritairement par des femmes, agit comme une technologie du corps et de l’esprit, offrant une voie légitime pour négocier le mal-être, la maladie et les tensions sociales que les approches conventionnelles ne parviennent pas à apaiser.
Genèse, filiation et diffusion africaine
L’origine du Zār est endogène au continent africain, un fait fermement établi par les analyses historiques. Les travaux universitaires du début du XXe siècle, confirmés par l’Encyclopédie de l’Islam en 1934, situent le foyer originel du culte dans les hauts plateaux d’Abyssinie (Éthiopie), notamment dans le nord, en région Amhara, autour de la ville de Gondar. Certains chercheurs suggèrent que l’étymologie du mot Zār pourrait dériver du terme couchitique Jâr (ou Ajara), qui désigne originellement un seigneur, un dieu ou le ciel. Le passage de “divinité” à “esprit maléfique” ou “démon” (Zär) se serait produit lors des contacts entre les Oromos et les populations chrétiennes Amhara d’Éthiopie, vers le XVIe siècle. Le consensus africain est renforcé par le fait que le rituel, déjà décrit par le voyageur William Cornwallis Harris sous le nom de sár au début du XIXe siècle, s’est d’abord propagé à l’intérieur du continent.
La diffusion de ce culte n’est pas une importation externe, mais une propagation intra-africaine du Nil Supérieur vers ses deltas, suivie d’une expansion transcontinentale. Le Zār est introduit en Égypte et en Nubie (le nord du Soudan et le sud de l’Égypte) de manière significative à partir du XVIIIe siècle et surtout au début du XIXe siècle, principalement par le truchement des esclaves éthiopiens employés dans les harems ottomans. Cette migration d’un culte de la Corne vers le bassin du Nil s’est faite par capillarité et adaptation, s’enracinant profondément en Nubie avant d’atteindre le Caire.
Il est crucial de souligner qu’aucune source fiable ne relie le Zār à l’Égypte pharaonique. Le phénomène est une importation relativement récente des hauts plateaux éthiopiens, s’étant développé au sein des cultures africaines post-ottomanes et islamisées, sans lien avec l’antiquité égyptienne.
Le Zār s’inscrit dans un ensemble plus vaste de cultes de possession thérapeutiques africains. On retrouve des variantes structurellement similaires sur le continent, témoignant d’une tradition pan-africaine d’attribution des maladies psychiatriques (au sens moderne) ou des malaises persistants à une possession spirituelle. Ces variantes africaines notables incluent le culte Bori chez les Haoussas d’Afrique de l’Ouest, le phénomène dinia chez les Nouba au Soudan, ou encore le Ndepp au Sénégal. Le culte s’est également étendu dans la diaspora et a été largement documenté au-delà, atteignant même le sud de l’Iran (notamment sur l’île de Qeshm) où il est interprété comme un « vent mauvais » portant divers noms (Maturi, Bābur, Bibi).

Cosmologie, hiérarchie spirituelle et dynamiques sociales
Dans la cosmologie éthiopienne et au-delà, le terme Zār désigne un groupe d’esprits (ou de démons) et les croyances qui les entourent. Ces entités sont une force surnaturelle invisible, jugée capable de prédire l’avenir, de résoudre même des problèmes internationaux, d’agir comme un héros courageux à la guerre, et d’être un guérisseur efficace pour de nombreuses maladies (sauf les maladies vénériennes), tout en étant capable de provoquer destructions et épidémies si le respect n’est pas observé. Ils sont conceptualisés différemment des esprits abdar, considérés comme bénéfiques et protecteurs.
La triade des Esprits Zār et la lecture sociale
La richesse du Zār réside dans la typologie détaillée de ses esprits. L’anthropologue I. M. Lewis (1971) a classifié le Zār parmi les cultes de possession périphériques, où les esprits représentent souvent l’oppression ou la marginalisation sociale. Ils sont structurés en hiérarchies complexes, souvent divisées en « tribus » dont la triade Rouges/Noirs/Pacha demeure la plus connue et la mieux documentée (notamment dans les études de Janice Boddy, I.M. Lewis et Jean Buxton).
1. Les Zār rouges (Zār Hamr ou arabes)
Ces esprits sont d’origine symbolique arabe ou bédouine, souvent liés au monde musulman et à la noblesse ancienne. Ils sont associés à la noblesse, sont fiers, aristocratiques, capricieux et autoritaires. Leur couleur symbolique est le rouge — couleur du sang, de la guerre et de la puissance. Ils manifestent leur présence par des symptômes liés au sang (anémie, règles douloureuses, saignements inexpliqués), des états de fatigue extrême ou des vertiges. Pour être apaisés, ils exigent des parfums rares, des tissus rouges, du henné et un langage rituel souvent teinté d’arabe. Leur culte manifeste une influence islamo-arabe ancienne, leur statut reflétant le pouvoir spirituel et le prestige de l’influence islamique dans la région.
2. Les Zār noirs (Zār Tikur ou Africains)
Symboliquement originaires des peuples africains autochtones, des esclaves ou des travailleurs manuels, ils sont plus rustiques, francs, impulsifs, parfois violents, et symbolisent la force physique et la terre. Leur couleur est le noir — couleur de la fertilité, du sol et de l’énergie vitale. Ils provoquent des fièvres, des maux de tête et des crises de transe souvent plus violentes. Leurs exigences rituelles sont ancrées dans la tradition africaine : danses intenses, tambours puissants, sacrifices d’animaux et consommation de bière locale (farso) ou d’aliments gras. Ils représentent les forces ancestrales du continent et montrent la continuité entre le Zār et les anciens cultes africains de possession, antérieurs à l’islam et au christianisme.
3. Les Zār pacha, Zār européens ou Zār militaires
Ces esprits sont des figures d’officiers ottomans, de Turcs, de Britanniques, ou d’Européens. Ils incarnent le pouvoir colonial, la modernité et la domination étrangère, se montrant dominateurs, autoritaires et stratégiques. Ils sont souvent associés au blanc, au doré ou au kaki militaire. Les symptômes typiques incluent la nervosité et les crises soudaines d’autorité, l’adepte adoptant des attitudes « militaires » durant la transe (marche au pas, salut, cris de commandement). Ils exigent des vêtements européens ou des uniformes (képi, bottes), ainsi que des produits associés à l’Occident comme les cigarettes, l’alcool et le café. Leur apparition dans le panthéon coïncide avec les périodes ottomane et britannique (XIXᵉ–XXᵉ siècles), transformant symboliquement la figure du colon ou du soldat en esprit possesseur.
Le fait qu’un esprit puisse être un Pacha Turc ou un Guerrier Éthiopien permet à l’adepte de verbaliser des tensions interculturelles, sociales ou historiques que la bienséance interdirait. Le monde des esprits Zār reflète ainsi les tensions historiques et identitaires du monde éthiopien et soudanais : entre l’Afrique et l’Arabie, la tradition et la modernité, le féminin et le masculin, la soumission et la résistance.
4. Autres catégories secondaires et adaptation géographique
En plus de la triade principale, le panthéon Zār démontre une grande souplesse en intégrant des esprits reflétant les environnements locaux et les flux commerciaux. Selon les régions (Éthiopie, Soudan, Égypte, Érythrée, Somalie), d’autres familles existent, comme les Zār de la mer (esprits marins ou commerçants, souvent féminins, liés aux populations côtières), les Zār des montagnes (esprits des forêts ou des lieux reculés) ou les Zār des morts (âmes d’ancêtres mal apaisées). L’influence des réseaux commerciaux de la mer Rouge est également palpable à travers les Zār étrangers, qui peuvent être d’origine indienne ou persane, ajoutant une dimension transcontinentale à la cosmologie. Ces catégories moins universelles soulignent la capacité du culte à incorporer les figures et les lieux du quotidien pour expliquer les infortunes.
Zār, genre et thérapie sociale
Le Zār est un refuge psychologique et social essentiel. Dans la région soudanaise, par exemple, l’anthropologue Natvig (1988) a rapporté que le culte offrait un sanctuaire aux femmes et aux hommes qualifiés d’« efféminés » dans un contexte de loi islamique stricte, leur permettant d’exprimer une identité marginalisée par l’intermédiaire de l’esprit. L’une des fonctions fondamentales du Zār est de décharger l’individu de la responsabilité de son mal-être. En attribuant les symptômes à un esprit, le culte évite le diagnostic social de la « folie » (un stigmate souvent intolérable) et offre une voie légitime de contestation de l’ordre familial patriarcal. La maladie devient une affaire spirituelle et non une défaillance personnelle, offrant une resocialisation et une nouvelle identité au sein du groupe.
Le Zār n’est pas monolithique et se décline en variantes spécialisées :
- Atete (ou Zār de Conversion) : Ce culte Oromo de la fertilité est l’équivalent du Zār de conversion chez les Amharas. Dominé par les femmes, l’esprit est souvent l’ayana de la mère. La possession, qui survient lors de cérémonies annuelles, se manifeste par des bâillements, des tremblements, des pleurs, mais aussi des actes extraordinaires comme monter aux arbres, manger des braises ou se couper sans ressentir de douleur, adoptant des comportements (voix, force, activité) radicalement différents de l’état normal. Le rôle principal des spectateurs est d’apaiser l’ayana par des chants, des applaudissements et des supplications.
- Zār du Voyant : Pratiqué par des hommes, le Zār du Voyant est celui d’un expert rituel, le Qalicha, qui a appris à contrôler son esprit. Une fois possédé, il peut répondre aux requêtes des clients concernant des objets perdus, ou, dans une pratique fascinante, lire l’avenir ou la solution à un problème dans la membrane du ventre d’un agneau sacrifié. Ce voyant doit observer des tabous stricts, comme éviter le contact avec les cadavres ou certains aliments qui déplaisent à son Zār.

Phénoménologie du rituel et cadre thérapeutique
Le culte du Zār est un rituel de musique, de danse et de transe dont le but n’est pas l’expulsion violente de l’esprit, mais l’établissement d’une relation harmonieuse et durable (tahdib) entre l’individu et l’entité spirituelle.
Le rôle central du Maître Zār et le diagnostic
Les cérémonies sont menées par des femmes initiées, les Sheikha (shaykha ou sheikha al-zār) ou, en Éthiopie, les bala Zār (zār bala). Ces figures de guérisseuses ou de prêtres sont souvent d’anciennes possédées qui, après un long apprentissage, ont appris à maîtriser leur propre esprit, d’autres héritant leur pouvoir ou affirmant avoir été « enlevées » par les esprits dans l’enfance.
Le processus commence toujours par le diagnostic. En Égypte et au Soudan, la Sheikha peut identifier l’esprit à travers des rêves, des encens, ou une méthode appelée kashf al-atar, consistant à dormir avec un vêtement du malade pour que le zār se manifeste en songe. En Éthiopie, le médecin-zār commence par identifier le type d’esprit à partir des symptômes : apathie, infertilité, troubles physiques ou mentaux. On dit alors qu’un esprit peut « chevaucher » la personne qu’il possède, et le possédé est appelé « mon cheval » par le zār, métaphore symbolique de la domination de l’esprit sur le corps humain.
La cérémonie de négociation et la transe
Les séances, qui peuvent se dérouler sur un à sept jours, se tiennent dans une atmosphère collective et sont guidées par la Sheikha qui agit comme un chef de séance, un médium et un thérapeute. La musique est centrale, dominée par la lyre à six cordes tanbūra (parfois appelée simsimiya au Soudan) et des percussions (tambours duff ou darabouka). L’un des instruments les plus distinctifs est le manjur, une ceinture en cuir ornée de sabots de chèvres qui produit un cliquetis sec et constant.
Le traitement commence par la négociation avec l’esprit. Le médecin l’invoque par la musique, le tambour et les hymnes, lui parle directement à travers le corps du possédé, et lui demande son nom et ses exigences. Dès que le nom du zār est révélé, son pouvoir diminue. Le rituel peut ressembler à un procès : le médecin interroge, les assistants chantent et frappent des mains, l’esprit répond à travers la voix du malade, guidant le rythme qui s’accélère progressivement pour induire un État Modifié de Conscience (EMC). La transe est une catharsis émotionnelle et physique intense, où l’esprit prend le contrôle et révèle ses désirs, établissant les termes de la cohabitation.
Le symbolisme nuptial et le sacrifice
Une fois que l’esprit est apaisé, on lui offre un maqwadasha, un « don d’amour » : parfum, tissu, perles, aliments et surtout un animal sacrificiel, souvent une poule ou un mouton. Le sang et la chair de la victime sont partagés entre le patient et les participants, établissant une réconciliation avec l’esprit.
Le rituel de guérison s’accompagne souvent d’un symbolisme nuptial très fort, marquant la fin du conflit intérieur et la réconciliation durable. Le possédé est appelé la « mariée du zār », vêtu de blanc et accompagné de ses assistantes appelées mize en Éthiopie. Au Soudan, notamment dans le culte du Tumbura et du Bori (souvent issus de communautés d’ascendance servile ou marginalisée), le symbolisme de la mariée et du mariage mystique avec l’esprit domine tout le rituel d’initiation (kursī), qui peut durer sept jours et se clôturer par « l’ouverture de la tête » (fakka-t-ar-rās), où la femme doit symboliquement manger la cervelle de l’animal sacrifié, signe de la fusion avec son esprit. Les pratiquants du Tumbura, souvent issus de communautés d’ascendance servile, trouvent dans ce culte un moyen de réhabiliter une identité positive face à une société hiérarchisée.
Diversité régionale des cérémonies
Les formes locales du culte illustrent l’ampleur du Zār :
Au Soudan, le culte du Tumbura est centré sur la musique de la lyre du même nom. Il suit quatre étapes précises : la divination, la thérapie de sept jours (retraite chez la prêtresse avec fumigations et chants), la cérémonie de remerciement (gadah al-bayād), et enfin l’initiation (kursī) qui fait du patient une « fille du Tumbura ». La lyre (rabāba) est un instrument quasi-sacré, transmis de maître à disciple.
En Égypte, le Zār, surtout pratiqué par les classes populaires, se divise en deux formes principales : le zār silencieux (al-sakt), intime et discret, fondé sur des sacrifices et des offrandes sans musique ; et le zār à tambours (daqqet), plus public, dont les cérémonies sont appelées hadra. Ce dernier est marqué par un fort syncrétisme, combinant éléments soufis (prières, invocation du Prophète, encens), croyances nubiennes et héritages africains, et où les musiciens observent le public pour repérer les signes de la transe.
Dans tous les cas, le sang et les restes du sacrifice, ainsi que d’autres offrandes, sont souvent jetés dans le Nil ou dans la mer pour clore le cycle rituel et purifier la relation entre l’esprit et le fidèle, symbolisant la renaissance du patient.

Le Zār face à la psychiatrie et à la modernité
Reconnaissance culturelle et psychiatrique
L’étude de Mesfin Samuel Mulatu sur quatre cent cinquante adultes dans le nord-ouest de l’Éthiopie confirme que les habitants attribuent davantage les maladies mentales aux facteurs de stress psychosociaux et à la punition surnaturelle qu’aux causes biomédicales. Cette perception justifie l’importance accordée aux traitements traditionnels comme le Zār et les soins familiaux.
Pendant un temps, le Zār a été brièvement reconnu par la psychiatrie occidentale comme un syndrome lié à la culture. Il a figuré dans l’édition DSM-IV-TR du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux sous la catégorie des « syndromes liés à la culture », où il était décrit comme une expérience d’épisodes de possession se manifestant par des cris, des rires, des chants ou des pleurs. Cependant, il a été retiré des classifications actuelles (DSM-5 et ICD-11), ce qui reflète une tendance à délaisser les diagnostics spécifiques à la culture. Les chercheurs spécialisés insistent sur le fait que la possession par le Zār doit être comprise dans son contexte socioculturel et non comme un trouble mental au sens strict, afin d’éviter la surinterprétation des symptômes de détresse comme des troubles psychiatriques.
Le destin du culte
Comme le souligne la recherche contemporaine, le Zār est un cas curieux d’une institution culturelle en voie de disparition (the disappearing Zar cult). Il tend à être dilué et à s’éteindre dans les zones urbaines modernes où la psychiatrie et les systèmes de santé formels gagnent du terrain. Les jeunes générations urbaines s’en détournent, considérant parfois le rituel comme désuet ou superstitieux.
Inversement, dans la diaspora éthiopienne et soudanaise (Amérique du Nord, Europe, Israël), le Zār conserve une pertinence culturelle. Il devient un marqueur identitaire et un moyen de gérer le stress de l’émigration et l’isolement social dans un nouveau contexte.
L’héritage du Zār se maintient aussi dans le domaine musical. Ses rythmes et son instrumentation, notamment la tanbūra, ont inspiré des genres musicaux modernes. Qu’il soit pratiqué en rituel secret de guérison ou transformé en performance artistique au Caire, le Zār demeure un puissant patrimoine culturel qui, par sa polyvalence et sa capacité à nommer l’indicible, continue d’assurer la souveraineté du corps et de l’esprit au-delà de la médecine.